Au cours du 20ème siècle, deux grands économistes ont dominé la scène intellectuelle en matière d’économie : Friedrich Hayek et John Maynard Keynes. Ils étaient à la fois amis et rivaux, s’affrontant sur leurs divergences de vues quant au rôle de l’État dans l’économie. Si Keynes défendait un interventionnisme étatique pour réguler l’économie et lutter contre les crises, Hayek prônait, lui, la libéralisation des marchés et une moindre intervention gouvernementale.
Keynes : l’interventionnisme étatique
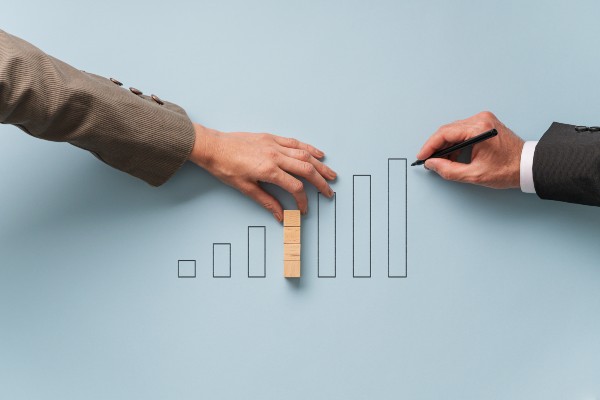
John Maynard Keynes est sans conteste le penseur le plus influent du 20ème siècle en ce qui concerne l’interventionnisme étatique. Selon lui, l’État doit jouer un rôle actif dans la régulation de l’économie pour éviter les crises et maintenir un niveau d’emploi élevé. Pour ce faire, il préconise des politiques monétaires et budgétaires expansionnistes, notamment en période de récession.
- Politiques monétaires : baisse des taux d’intérêt et augmentation de la masse monétaire pour stimuler la demande et relancer la croissance économique.
- Politiques budgétaires : hausse des dépenses publiques et/ou baisse des impôts pour soutenir la demande et l’emploi.
Hayek : le libéralisme économique
De son côté, Friedrich Hayek est considéré comme le grand théoricien du libéralisme économique. Selon lui, le marché est un « ordre spontané » qui s’autorégule grâce aux mécanismes de l’offre et de la demande. Ainsi, il estime que l’interventionnisme étatique est à la fois inefficace et dangereux, car il perturbe les processus naturels d’ajustement des marchés et peut mener à la « servitude ».
- Libéralisation des marchés : suppression des barrières réglementaires et tarifaires pour favoriser la concurrence et l’innovation.
- Réduction de l’intervention gouvernementale : limitation des subventions et des dépenses publiques, privatisation des entreprises publiques.
La traversée du désert de Hayek

Après la mort de Keynes en 1946, l’interventionnisme et le keynésianisme ont triomphé sur la scène économique internationale. Hayek a alors entamé une longue traversée du désert, mais sans jamais renoncer à défendre les vertus du libéralisme. Son manifeste de 1944, La Route de la servitude, dans lequel il affirme que l’interventionnisme mène inéluctablement à la servitude, est resté longtemps ignoré, avant de connaître un regain d’intérêt avec la montée du néolibéralisme dans les années 1980.
Un débat toujours d’actualité
Le débat entre Keynes et Hayek est loin d’être clos, et il continue de diviser les économistes et les responsables politiques à travers le monde. Alors que certains plaident pour une politique économique plus keynésienne, notamment face aux crises financières et économiques actuelles, d’autres prônent un retour aux principes libéraux défendus par Hayek. Les exemples récents de l’austérité en Europe ou des politiques de relance aux États-Unis montrent que ce débat reste au cœur des décisions économiques actuelles.
- Austerité vs relance : faut-il réduire les dépenses publiques et les dettes souveraines ou stimuler la demande et l’investissement pour sortir de la crise ?
- Politiques monétaires non conventionnelles : les mesures prises par les banques centrales (quantitative easing) sont-elles efficaces pour soutenir la croissance économique ou risquent-elles de créer de nouvelles bulles financières ?
- Régulation vs dérégulation : doit-on renforcer les régulations sur les marchés financiers et les entreprises ou favoriser la concurrence et l’innovation en allégeant les contraintes réglementaires ?
En somme, le débat entre Hayek et Keynes n’est pas seulement une querelle entre deux grands esprits du 20ème siècle, mais une opposition fondamentale entre deux visions de l’économie et du rôle de l’État dans la marche du monde. À ce titre, il mérite d’être étudié et compris pour mieux appréhender les enjeux économiques actuels et futurs.





